« Penser ensemble » en entreprise : une approche philosophique et humaniste
Avec la crise, tout se fissure. Le concept du philosophe Lévinas, intitulé sobrement « Penser ensemble », offre une voie pour remédier aux divisions et conflits d’intérêts. Exit les individualismes et les égos. Cette philosophie nous appelle à mieux dialoguer, partager et co-construire des savoirs.
Dès lors, comment repenser notre façon d’envisager le monde et l’entreprise ? Et surtout, comment redéfinir notre place en tant qu’êtres humains au sein d’une société profondément interconnectée ?

L’idée de communauté intellectuelle a toujours été présente dans la pensée philosophique. Des penseurs comme Martin Buber (1878-1965), ou Emmanuel Levinas, entre autres, (1906-1995) ont plongé dans l’exploration de l’engagement intersubjectif. Ce concept valorise la relation humaine. Elle contribue à unir les individus pour se comprendre, échanger et penser ensemble. Dit autrement, l’être humain ne peut être pleinement saisi en tant qu’entité isolée. Bien au contraire, c’est bien dans la relation à autrui, à travers la communication, que l’humanité se réalise.
Martin Buber incarne cette vision à travers son concept du « Je-Tu[1] ». Pour ce penseur israélien, tout se joue dans l’authenticité du dialogue. La véritable compréhension ne naît pas d’une introspection solitaire. Elle excelle plutôt dans la relation, où l’individu reconnaît l’autre comme un égal.
Emmanuel Levinas, lui, va plus loin. Il érige la responsabilité envers autrui comme le socle même de notre existence. Cette éthique dialogue avec l’idée de « Penser Ensemble ». Elle appelle au respect et à la valorisation de l’autre dans une réflexion partagée. Ainsi, « Penser ensemble » s’avère nécessaire pour appréhender le monde qui nous entoure. Et, ce en reconnaissant la pluralité et la diversité des expériences humaines.
Et quid d’une approche humaniste ?
L’humanisme célèbre la valeur de l’humain et la dignité de chacun. Appliqué au « Penser Ensemble », cette doctrine nous invite à considérer chaque individu dans le tissu social et celui de l’entreprise comme indispensable pour réhumaniser nos relations.
Et comment y répondre, sinon en s’appuyant sur l’empathie et le respect. Ensemble, ils sont à même d’apporter des contributions uniques à la réflexion collective.
Les dimensions du « Penser ensemble »
Empathie, esprit critique, pensée collective… Sous le prisme humaniste appliqué à la collaboration intellectuelle et opérationnelle, elles trouvent leur pleine expression. Elles concourent à réhabiliter l’humanité dans les relations.
Pensée empathique
L’empathie nécessite une capacité à saisir et ressentir les perspectives d’autrui. Cela implique un exercice d’écoute active. Elle suppose, en outre, la création d’un espace sécurisé où chacun peut partager ses idées sans crainte de jugement. Dans ce climat de confiance, la créativité et l’innovation bénéficient alors d’un terrain favorable.
Pensée critique
Penser Ensemble ne se contente pas d’encourager l’entraide et la coopération. Il s’arcboute également sur l’esprit critique. Ici, le débat n’est pas un vain mot : il se fait vigoureux, parfois contradictoire, mais dans une entente respectueuse.
Dans cet espace d’échange, chaque voix compte, chaque idée est soupesée, contestée, enrichie. C’est dans cette confrontation que se forge une compréhension plus fine des enjeux les plus complexes.
Pensée collective
Sur le plan cognitif, le Penser Ensemble représente une démarche qui s’inscrit dans une dynamique collective. Et les entreprises, les communautés scientifiques ou les initiatives citoyennes plébiscitent cette démarche. Cette dernière repose sur l’idée que la collaboration est propice à l’émergence des solutions et idées. Leur petit plus ? Elles se révèlent bien plus innovantes et solides que celles qu’un individu pourrait concevoir seul.
Synergie des savoirs et des expériences
Chaque individu enrichit le groupe par ses schémas cognitifs propres, des connaissances spécifiques et des perspectives uniques.
Ces contributions font ainsi jaillir des idées neuves. Mieux encore : ce processus de pensée collaborative désamorce les biais individuels grâce à la lucidité des autres.
Dialogue inclusif et collaboration interdisciplinaire
Certes, les réseaux sociaux tissent des interconnexions plus vastes. Mais les bulles de filtrages étiolent les idées. La mission consiste donc à favoriser réellement le dialogue inclusif et la collaboration interdisciplinaire. Comment ? En imaginant des formats et des plateformes libérés de toute entrave.
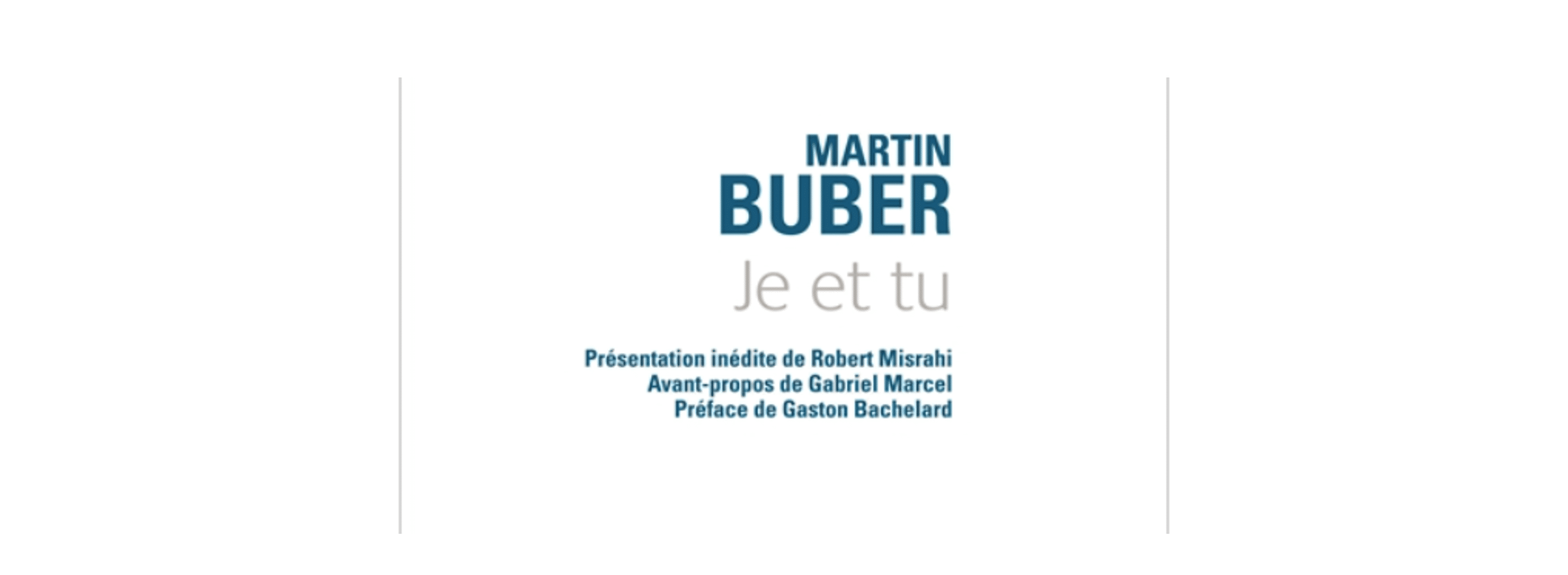
«Penser ensemble» : un élan collectif vertueux voué au progrès
En somme, le « Penser Ensemble » ne se limite pas à une approche philosophique de salon. Il célèbre le ralliement humaniste face aux complexités du monde moderne. En cultivant l’art du dialogue, de l’écoute et de la co-création, il ouvre la voie à une société plus solidaire, plus juste plus résiliente.
Chez Onepoint, ce « Penser Ensemble » constitue le catalyseur d’une intelligence collective et collaborative. Nous avons construit un creuset où les esprits bouillonnent et s’entrelacent pour accoucher du meilleur. Cette approche érige ainsi notre groupe en une maison où chaque voix trouve son écho et contribue à notre croissance.
Le « Penser Ensemble » naît là où s’entrecroisent la verticalité de notre leadership, portée par notre président-fondateur, et l’horizontalité de notre vivier humain. Et ce dernier donne à chacun les rênes de son propre récit, personnel comme professionnel.
Le « Penser ensemble » constitue donc bien la pierre angulaire d’un équilibre harmonieux dans l’entreprise.
La singularité, autre composante du « Penser ensemble » est exaltée. A condition qu’elle enrichisse nos humanités et affine l’excellence de nos expertises.
Les convictions de Onepoint s’incarnent par définition dans des actions concrètes menées par l’ensemble des collaborateurs.
Il en va ainsi, par exemple, de l’Institut Onepoint. Cette entité transverse du groupe structure et centralise nos activités de R&D. Ce qui est inédit parmi le paysage des cabinets de conseil français.
On pourrait citer en outre la formation chercheur entreprenant, qui vient travailler la culture de la valorisation de la recherche en entreprise pour répondre aux enjeux de la société et du marché.
Enfin, la fresque de l’équilibre harmonieux témoigne de la diversité de notre approche. Cet atelier d’intelligence collective et jeu d’enquête inédit stimule les consciences et le dépassement de soi des plus jeunes d’entre nous vers les métiers des nouvelles technologies.
De la pensée à l’action, Onepoint incarne un nouveau modèle d’entreprise. Nous pourrions le désigner sous le terme d’écosystème vertueux. Ici, le bien commun rejoint les intérêts du marché et des individus, pour plus de progrès et de croissance.
[1] BUBER, Martin. Je et Tu. Traduit par Geneviève Bianquis. Paris : Aubier, 1969.
