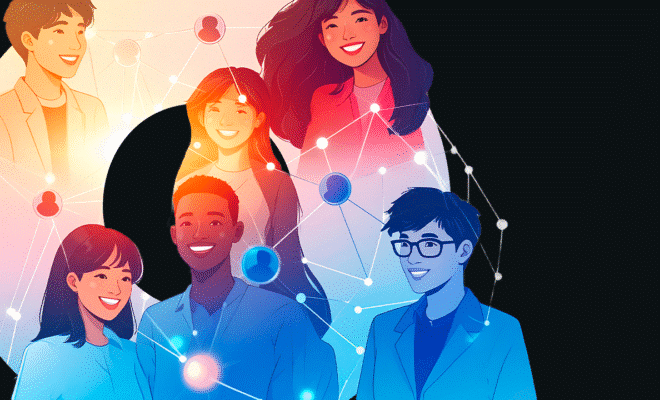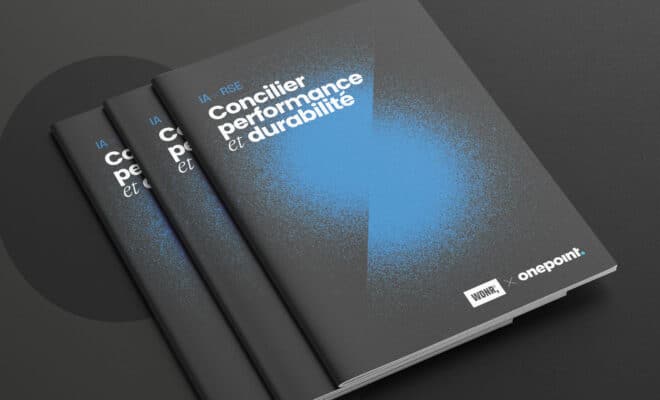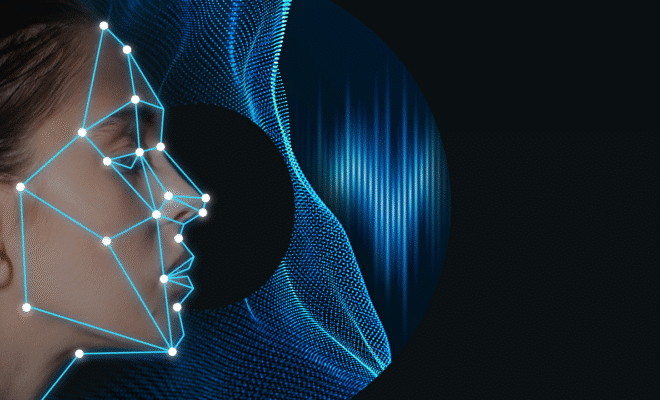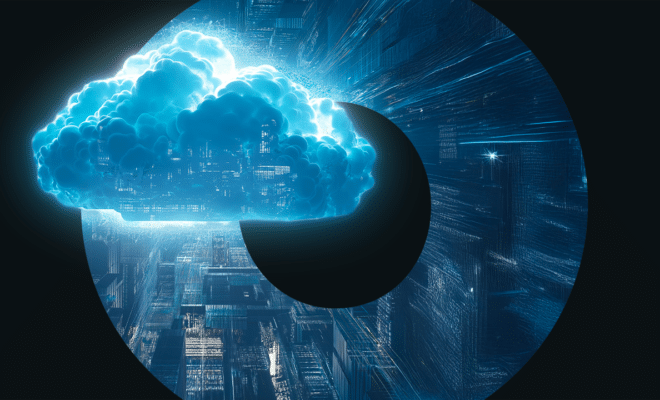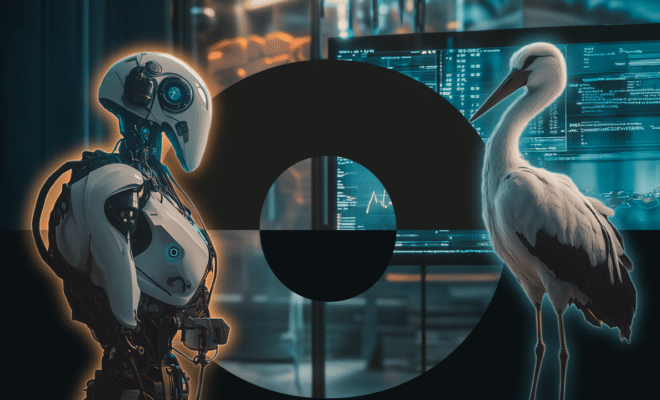Préserver notre humanité à l’ère de l’intelligence artificielle, pour une résistance humaniste.
Serions-nous entrés dans le Siècle des Lumières administrées ?
Notre seule fonction deviendrait-elle de tourner un commutateur. Serions-nous réduits alors réduits au rôle d’exécutants ? Si tel est le cas, nous ne serions plus que le sujet mécanique d’un geste automatique. Le philosophe Gaston Bachelard discernait dans le simple fait d’allumer une chandelle l’occasion de « constituer, en un orgueil légitime, le sujet du verbe allumer1». Or, l’automatisation nous dépossède de cet orgueil légitime de l’action.
L’éducation, depuis toujours, est l’art de transmettre ce qui fait de nous des humains : la capacité de penser, de douter, de créer du sens. Or, à l’ère de l’intelligence artificielle, cette mission s’effrite.
Nous vivons, de la sorte, une mutation ontologique. Pour la première fois, la machine ne se contente plus de prolonger nos bras ou nos sens. Elle prétend prolonger notre esprit.
L’illusion de l’intelligence : quand la pensée devient simulation
Les algorithmes ne pensent pas, ils calculent. Et c’est précisément ici où se place l’illusion de l’intelligence, quand la pensée devient simulation. Mais leur puissance mimétique trouble : ils rédigent, traduisent, répondent, dessinent, comme nous. Et là est bien le piège. Dans cette confusion entre pensée et performance, intelligence et traitement, l’humain risque de perdre ce qui constitue sa singularité. Je veux évoquer par-là, entre autres, sa lenteur, ses erreurs, ses doutes, sa profondeur, son éveil des sens.
L’IA est fascinante dans sa capacité à réaliser des tâches complexes. Mais son efficacité semble désormais nous contraindre à coopérer avec elle. Ce faisant, l’IA tend à court-circuiter la dimension interrogative de l’esprit.
Or, la véritable pensée n’est pas instantanée. Elle est un processus lent et inconscient. C’est une maturation cognitive qui requiert le doute et la recherche initiale. Et l’IA nous fournit la solution sans que nous ayons eu le temps de chercher sans y penser.
Le risque de l’intelligence consiste à nous donner l’illusion qu’en trouvant grâce à elle, nous avons pensé avec elle ; c’est un mirage. L’élève, confronté à une machine omnisciente, cesse de questionner pour seulement demander. L’éducation bascule ainsi d’un désir de comprendre à la gestion de réponses.
La réification silencieuse ou la chosification de l’humain : devenir données parmi les données
Cependant, le risque le plus profond n’est pas la dépendance technique, mais la réification, ce processus par lequel l’humain devient chose, donnée, profil. Comme le décrivait Hannah Arendt, le danger moderne est celui d’un monde où l’homme n’est plus sujet d’action2, mais objet de calcul3.
Quand l’élève est réduit à des métriques d’attention, quand le professeur est remplacé par un modèle prédictif d’apprentissage, la relation éducative, cet espace fragile où naît la conscience, se dissout dans un flux de données.
La promesse d’une éducation « personnalisée » devient alors presque un paradoxe : une personnalisation sans… personne. Comme si l’outil devenait un « sujet » presque humanisé et cible de désir, et le sujet, cet Être Humain, devenait un « objet ». Une sorte d’inversion des rôles et des fonctions, de l’essence même de notre humanité.
Face à l’IA générative, nous risquons de nous désincarner doucement, laissant nos pensées glisser hors de nous pour se fondre dans des formes qui ne portent plus notre souffle. À force de nous subordonner aux outils, la pensée se vide, se prolétarise, devient écho plutôt qu’élan. Rester humain, aujourd’hui, c’est préserver ce lieu fragile où la voix n’est pas encore un calcul.
L’éducation comme résistance : retrouver la chair de l’esprit
L’enjeu ici n’est évidemment pas de rejeter l’IA et l’IA générative, mais de la resituer. Il ne s’agit pas de s’opposer à la technique ou à la technologie mais de s’en emparer avec soin. Plus que jamais il convient de repenser le mode d’existence des objets techniques, comme nous y invitait le philosophe Gilbert Simondon4.
A plus forte raison quand il s’agit de l’école, notre coexistence avec l’IA nous impose de réapprendre à penser par nous même avec la machine, non contre elle et surtout pas comme elle.
Cela suppose une pédagogie de la conscience : apprendre aux enfants non plus à coder, mais à décoder, à lire les biais, à interroger les sources, à discerner la logique derrière l’illusion. Apprendre à dire non à la vitesse, à l’instantané, au confort cognitif. Réapprendre à contempler, à écrire, à douter autant d’actes de résistance face à la fluidité algorithmique. C’est à cela que Paul Valéry nous invitait déjà, dans la fiction d’une société d’hommes vivant en ermite, loin du tumulte du monde et de la technique5.
Mais à la fable de l’érémitisme, nous pouvons substituer l’ambition d’une école à nouveau humaniste, tournée vers les humanités et l’épanouissement moral des élèves et étudiants, en équilibre avec la nécessité de comprendre les technologies, pour les maitriser et bien les utiliser.
Rester incarner dans notre condition humaine à l’ère de la grande métamorphose par l’IA serait donc un défi global, universel, humaniste, peut-être même le seul défi collectif jamais lancé à l’Humanité. Serons-nous à même de le relever ?
Références
- Gaston Bachelard, « Flamme d’une Chandelle », Chapitre V, LA LUMIÈRE DE LA LAMPE, page 75, 113 pages, Paris : Les Presses universitaires de France (PUF), 1re édition, 1961. ↩︎
- Hannah Arendt, « The Human Condition », The University Of Chicago Press Chicago & London, 372 pages 1958. Hannah Arend y établit la distinction fondamentale entre travail, œuvre et action. Hannah Arendt examine l’humanité à travers les actions dont elle est capable. Elle identifiait déjà ces problème : l’affaiblissement de la capacité d’agir et de la liberté politique. A cela s’ajoute le paradoxe selon lequel, à mesure que nos pouvoirs s’accroissent grâce au progrès technologique et scientifique, nous devenons de moins en moins capables d’en maîtriser les conséquences.↩︎
- Cette affirmation est liée à la critique d’Hannah Arendt sur la société de masse et des régimes totalitaires. Dans ces contextes, l’individu y est dépersonnalisé et traité comme une unité interchangeable dans un système bureaucratique, prêt à être manipulé selon les calculs du pouvoir. Hannah Arendt, « The Origins of Totalitarianism », Harcourt Brace & Co. 1951.↩︎
- « La culture s’est constituée en système de défense contre les techniques ; or, cette défense se présente comme une défense de l’homme, supposant que les objets techniques ne contiennent pas de réalité humaine. Nous voudrions montrer que la culture ignore dans la réalité technique une réalité humaine, et que, pour jouer son rôle complet, la culture doit incorporer les êtres techniques sous forme de connaissance et de sens des valeurs. » Gilbert Simondon, « Du mode d’existence des objets techniques », Introduction, page 9, 182 pages, Éditions Aubier-Montaigne, 1958.↩︎
- Référence aux écrits de Paul Valéry sur la figure de Monsieur Teste, notamment dans La Soirée avec Monsieur Teste (1896), où le personnage incarne l’intellect pur et la maîtrise de soi par le retrait du monde et des contingences extérieures. Ce retrait est interprété ici comme une résistance à la dissolution de la conscience individuelle dans le flux (technologique) continu. Monsieur Teste, « La Soirée avec monsieur Teste », wikisource.org, 1896. ↩︎