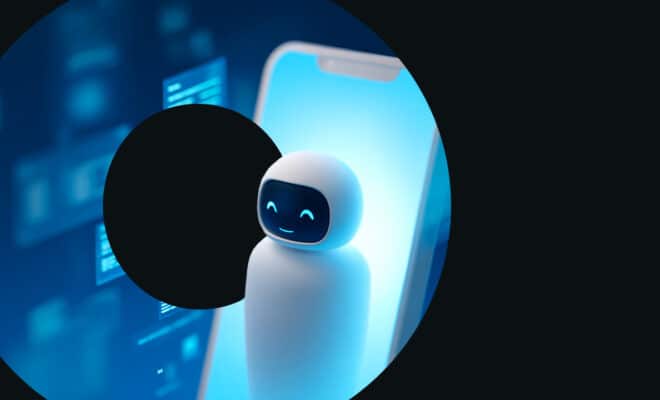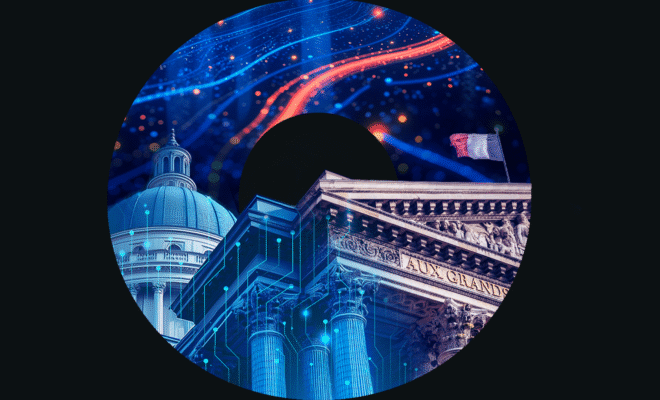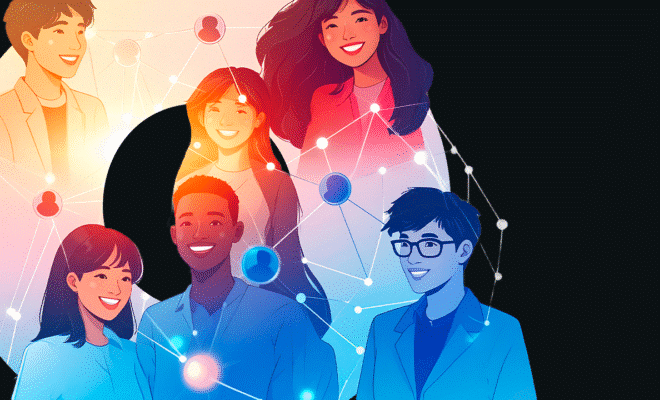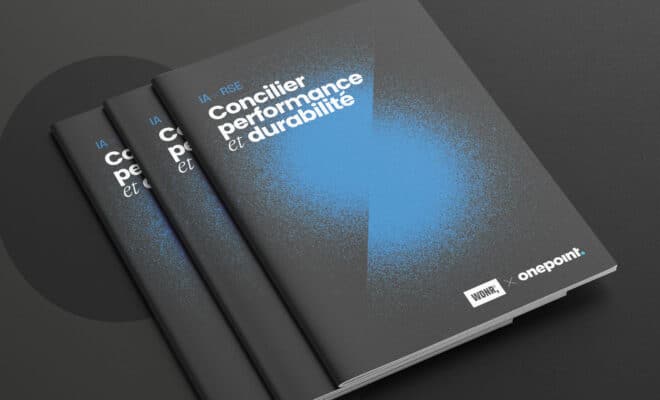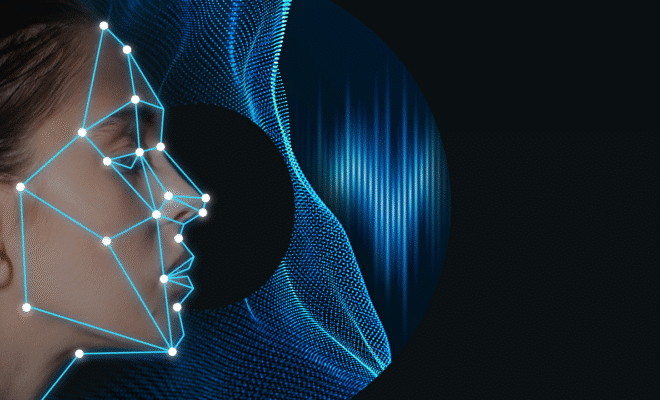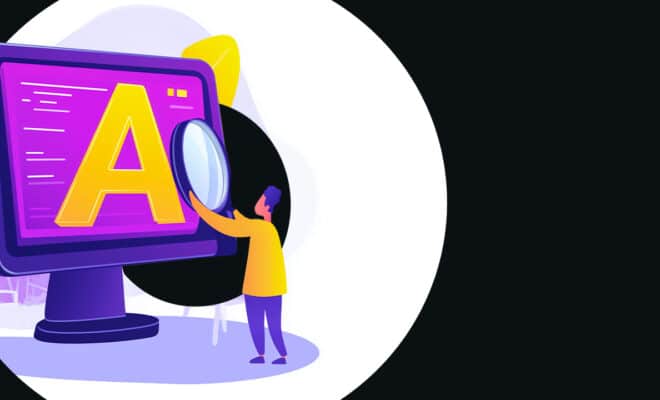Data centers : enjeux et leviers pour une intégration territoriale maîtrisée
Infrastructures invisibles mais bien réelles, les data centers s’imposent désormais comme un sujet stratégique pour les territoires. L’essor du cloud et de l’intelligence artificielle ne fait qu’accentuer le déploiement de ces infrastructures numériques dans l’hexagone. Dès lors, comment les territoires peuvent-ils accueillir ces géants énergivores, tout en conciliant sobriété et développement territorial ?
L’ère du numérique a érigé les data centers en infrastructures critiques et incontournables pour notre économie. En mai 2025, le Sommet Choose France a confirmé cette dynamique avec l’annonce de 53 projets d’investissements étrangers, pour un montant de 40 milliards d’euros [1]. Positionnant la France comme destination privilégiée en Europe pour le développement des centres de données. Ces « usines numériques », qui soutiennent le cloud, l’intelligence artificielle et le traitement de volumes massifs de données, sont au cœur de la transformation digitale.
Mais leur implantation exige de vastes emprises foncières et une alimentation énergétique considérable. Selon l’ADEME, la consommation électrique des data centers pourrait représenter 6% de la demande électrique nationale en 2050 [2].
Face à la saturation foncière en zone urbaine et aux tensions sur le réseau d’électricité, les opérateurs se tournent vers de nouveaux territoires. Derrière chaque projet se jouent des arbitrages fonciers, énergétiques, économiques et sociaux. Face à ces enjeux, comment les collectivités peuvent-elles encadrer le développement de ces infrastructures numériques pour concilier transition numérique et sobriété territoriale ?
Pour éviter de subir ces implantations, les collectivités doivent se doter d’une stratégie d’accueil. Celle-ci peut passer par des critères d’acceptabilité liés à leur implantation : créer des emplois locaux, privilégier les friches ou terrains déjà artificialisés, exiger la valorisation de la chaleur fatale, et intégrer les data centers dans des projets urbains mixtes qui renforcent leur utilité locale.
Un marché en forte expansion
La France s’impose comme l’une des destinations les plus attractives pour les opérateurs de data centers. Sa production d’énergie décarbonée et le projet de loi de simplification de la vie économique [3] pour faciliter les démarches administratives des projets, sont des atouts majeurs.
L’Île-de-France, cœur historique du marché
La France héberge 322 data centers dont 136 en Île-de-France selon la plateforme Cloudscene [4]. Les opérateurs, français comme internationaux, déploient une offre de services diversifiée sur le territoire national proposant du cloud, de la colocation et d’edge computing[5].
La majorité des sites se trouvent en petite couronne, dans des communes telles qu’Aubervilliers, Saint-Denis, Pantin ou la Courneuve. Ce choix d’implantation s’explique par la proximité des grandes entreprises, la densité du réseau électrique et la qualité des infrastructures de fibre optique.
D’autres territoires jouent aussi un rôle clé. Marseille s’affirme comme porte d’entrée grâce à ses câbles sous-marins de télécommunication reliant l’Europe aux autres continents. Et dans les Hautes-de-France, l’acteur historique OVH a façonné un ancrage solide. Mais la montée en puissance de l’intelligence artificielle incite les opérateurs à élargir leur périmètre d’implantation au-delà de ces bastions traditionnels.
Nouveaux besoins portés par l’intelligence artificielle
L’essor de l’IA a provoqué une transformation radicale des besoins des opérateurs. Il y a quelques années, les projets des data centers portaient sur 30 à 50 MW IT [6].
Aujourd’hui, les ambitions sont montées à 70 voire 90 MW IT, avec des opérateurs qui n’investissent que s’ils peuvent atteindre à terme 200 MW IT sur un même site.
Cette évolution restreint drastiquement les emplacements disponibles et rend le choix des terrains plus stratégique. Le site de Data4 à Marcoussis (133 hectares, 500 MW) [7], longtemps perçu comme une exception, illustre cette évolution, en revalorisant des territoires auparavant délaissés.
Cette dynamique attire également des investisseurs internationaux. La firme canadienne Brookfield s’est engagée à investir 20 milliards d’euros sur cinq ans dans des data centers en France et tripler leur capacité d’ici 2030 [8].
Le marché de data centers se diversifie, tant dans ses localisations que dans ses modèles économiques. Certains pays comme Malte misent sur des campus géants pour attirer les investissements. En France, la Côte d’Opale et le Grand Est émergent comme des territoires offrant des alternatives crédibles aux zones saturées.
Des infrastructures numériques bien physiques et des enjeux environnementaux à ne pas sous-estimer
Bien que le numérique soit souvent perçu comme immatériel, les data centers sont, par nature, des infrastructures physiques. Les serveurs aux systèmes d’alimentation redondants en passant par les dispositifs de refroidissement, consomment et interagissent fortement avec leur environnement.
Quand la valeur d’un data center dépasse le foncier
Accueillir un data center n’est pas une opération neutre sur le plan territorial. Chaque projet dépend étroitement du contexte local et se traduit par des configurations architecturales particulières. Pour donner un ordre d’idée, un « module » de data center, occupe environ 2 000 m². Cela équivaut à la surface de quatre terrains de basket. Pour son fonctionnement, il nécessite toutefois entre 8 et 9 MW d’électricité, l’équivalent de la consommation d’une ville de 8 000 à 9 000 habitants.
La valeur d’un data center ne réside pas dans sa seule emprise foncière. Contrairement à l’immobilier classique, c’est la densité des équipements installés et la criticité des clients hébergés qui déterminent sa rentabilité. Un site bien connecté avec des acteurs stratégiques vaut plus qu’un site vide.
Pour les collectivités, l’enjeu est d’évaluer finement la demande locale et régionale des entreprises. Cela suppose de mener des études pour qualifier leur besoin.
Par exemple, cibler les entreprises susceptibles de rapatrier leurs données, les opérateurs de services publics cherchant un hébergement local, ainsi que les besoins liés à l’IA, à l’IoT ou la cybersécurité. C’est l’adéquation entre offre et demande qui conditionne la pertinence d’un projet et sa contribution au territoire.
Des enjeux environnementaux majeurs et les limites de la valorisation de la chaleur fatale
Les data centers ont un impact environnemental important. Ces infrastructures fonctionnant en continu nécessitent un refroidissement intensif et consomment de grandes quantités d’eau selon les technologies employées. La consommation électrique estimée pour l’ensemble des data centers est de 10 TWh, soit 2% de la consommation française en électricité sur l’année [9]. Selon l’ADEME, ce chiffre pourrait grimper à 6 % d’ici 2050 si les tendances actuelles se confirment.
La réglementation européenne impose aux data centers de plus de 1MW de valoriser la chaleur fatale issue de leur fonctionnement quand c’est techniquement possible [10]. Certaines technologies de refroidissement innovantes, comme l’immersion liquide, permettent d’envisager leur récupération à des fins de chauffage local.
C’est ainsi que l’entreprise Stimergy a récupéré la chaleur émise par les serveurs installés dans le sous-sol du bassin de la Butte aux Cailles, permettant de chauffer l’eau de la piscine [11]. Toutefois, ces projets restent encore peu répandus en France.
La valorisation est complexe en raison de freins techniques (type de système de refroidissement, température de la chaleur récupérable), de rentabilité économique (coût d’adaptation et de raccordement), ou encore la synchronisation des besoins entre producteur et consommateur qui sont autant d’obstacles à surmonter.
La proximité géographique avec des utilisateurs potentiels et l’alignement des durées d’engagement entre opérateurs et gestionnaires de réseaux demeurent également des prérequis souvent difficiles à concilier.
Les collectivités doivent identifier les besoins de chaleur sur le territoire en réalisant des études d’opportunité spécifiques ou dans le cadre d’un document de planification urbaine.
Une opportunité… à condition d’en maîtriser les leviers
Pour une collectivité, l’implantation d’un data center peut être un levier d’attractivité et de rayonnement territorial et générer des avantages en termes de recettes fiscales, de création d’emplois et de contribution à la filière numérique locale.
Un actif immobilier au service du renouvellement urbain
Les data centers offrent une opportunité de reconversion de friches industrielles, tertiaires ou commerciales. En s’implantant sur des sols déjà artificialisés, ils contribuent à la sobriété foncière et au renouvellement urbain.
À la Courneuve, la société américaine Digital Realty a ainsi transformé une ancienne friche en un data center comprenant 40 000 m² de salles IT et nécessitant 130 MW de puissance pour fonctionner [12].
D’autres projets se distinguent pour leur mixité, comme « DataHills », à Aulnay-sous-Bois, prévu sur l’ex-usine Citroën et associant data center et un bâtiment de bureaux.
Ces initiatives participent à la structuration de l’écosystème numérique local : services IT, cybersécurité, IA, Cloud et formations spécialisées. Elles peuvent aussi renforcer la souveraineté numérique en garantissant un hébergement local des données.
Un levier stratégique aux bénéfices locaux limités
Un data center génère peu d’emplois permanents en phase de fonctionnement (12 emplois en moyenne pour 1 000 m² exploités). A la Courneuve, le site PAR8 de Digital Realty illustre ce constat avec seulement 90 salariés, dont 40% habitent dans l’agglomération Plaine Commune [13]. Ce faible apport interroge sur l’intérêt économique en matière d’emplois locaux, même pour des projets d’envergure.
L’évaluation territoriale d’un data center ne peut cependant se limiter à ce critère. Son implantation peut devenir un véritable levier stratégique : stimuler les services externalisés comme les réseaux de chaleur, la maintenance ou la cybersécurité, encourager la formation dans les métiers du numérique, attirer des entreprises innovantes allant des startups aux industriels du cloud.
Ces attraits territoriaux doivent cependant être mis en balance avec certaines contraintes telles que la forte consommation d’énergie, la tension foncière et l’impact environnemental. D’autant que les bénéfices pour les riverains ne sont pas toujours visibles. Sans prise en compte de ces limites, le développement des centres de données risque de s’accélérer de manière non maîtrisée, exposant les territoires à des tensions supplémentaires.
Nos recommandations sur les principes d’intégration urbaine et critères de durabilité
Un data center ne constitue donc pas qu’un bâtiment technique. C’est une infrastructure urbaine majeure, comparable en taille et en énergie à une petite ville, et qui doit s’adapter au contexte local.
Face à ces enjeux, les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle central dans l’évaluation, l’encadrement et l’intégration de ces infrastructures numériques sur leur territoire.
Ces enseignements nous conduisent à proposer des pistes de réflexion à intégrer dans une démarche proactive à destination des décideurs publics :
- Intégrer les projets de data centers dans une vision stratégique de l’aménagement du territoire (cohérente par rapport aux enjeux à l’échelle régionale) et articulée avec les besoins locaux, les priorités environnementales et les filières économiques. Les projets doivent viser une intégration urbaine soignée et une programmation mixte (data center, bureaux, services, formation et R&D), pour optimiser l’usage du foncier et renforcer l’acceptabilité sociale. Des designs modulaires et compacts, voire des constructions verticales, peuvent être encouragés dans les zones urbaines.
- Privilégier des implantations sur des friches ou terrains déjà artificialisés, pour limiter la pression sur le foncier et favoriser des projets sobres.
- Encadrer les projets par des critères d’acceptabilité : performance énergétique, valorisation de la chaleur fatale, intégration urbaine, labellisation environnementale.
- Évaluer en amont les infrastructures et ressources existantes (énergie, télécoms, eau) pour garantir la compatibilité et la résilience du territoire. Un diagnostic territorial précis est indispensable pour évaluer la capacité réelle du réseau électrique, l’accès à une ressource en eau suffisante et la proximité de réseaux de télécommunication performants et redondants. Cela permet d’identifier les zones les plus adaptées et d’éviter les tensions sur les infrastructures locales.
- Dialoguer avec les opérateurs privés pour mieux comprendre leurs besoins tout en leur présentant les attentes de la collectivité. Un dialogue prospectif avec les opérateurs (énergétiques, télécoms) et une étude des besoins des entreprises locales sont nécessaires pour orienter la typologie des data centers à privilégier et maximiser les retombées pour l’écosystème numérique local.
Et surtout, associer les acteurs du territoire dans une gouvernance partagée à l’échelle régionale, afin d’inscrire ces infrastructures dans une dynamique de transition numérique responsable.
Les collectivités territoriales au premier plan pour l’intégration des data centers
En somme, les collectivités territoriales ont aujourd’hui un rôle central à jouer comme actrices éclairées d’un aménagement numérique responsable.
L’objectif est de comprendre les implications de ce phénomène en pleine expansion et de proposer une démarche afin de permettre aux décideurs publics de prendre des décisions alignées avec les ambitions du territoire.
Plutôt que de subir un effet d’aubaine lié aux capacités financières des investisseurs et au développement massif de l’intelligence artificielle. Les territoires doivent définir des critères précis pour que l’accueil de ces infrastructures contribue positivement au développement économique local, au rayonnement numérique, à la reconversion de friches et à la structuration d’écosystèmes innovants. Tout en valorisant au mieux les externalités positives et en minimisant les externalités négatives.
L’implantation d’un data center n’est jamais un sujet neutre. Mais il peut, dans certaines conditions, devenir un levier de transformation au service d’une politique numérique ambitieuse, sobre, et alignée avec les impératifs environnementaux. Les collectivités territoriales ont aujourd’hui un rôle à jouer : non pas seulement comme guichet d’autorisation, mais comme actrices éclairées d’un aménagement numérique responsable.
Pour aller plus loin dans une approche responsable et stratégique, échangeons sur la manière dont votre territoire peut tirer le meilleur parti de ces infrastructures.
® m.cardenas-garcia@groupeonepoint.com ® p.hoguet@groupeonepoint.com
Crédits Mariana Cardenas, consultante senior Smart City and Places, Onepoint Pascal Hoguet, directeur de projet Smart City and Places, Onepoint
[1] Ministère de l’économique, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, « IA : des investissements records annoncés lors du Sommet Choose France 2025 » : https://www.economie.gouv.fr/actualites/ia-des-investissements-records-annonces-lors-du-sommet-choose-france-2025# [2] ADEME, Avis d’experts – Les data centers ou centre de données au centre de la transition numérique, novembre 2024 [3] Site vie-publique, « Projet de loi de simplification de la vie économique », 17 juin 2025 : https://www.vie-publique.fr/loi/293913-entreprises-projet-de-loi-de-simplification-de-la-vie-economique [4] Cloudscene, Data Centers en France, 2025 : https://cloudscene.com/market/data-centers-in-france/all [5] Définition Edge Computing : l’informatique de périphérique permet aux appareils situés dans des emplacements distants de traiter des données à la « périphérie » du réseau, soit par l’appareil, soit par un serveur local. [6] Définition MW IT : capacité de charge informatique ou capacité installée, qui est la quantité d’énergie consommée par les serveurs et les équipements réseau installés. Cette capacité est mesurée en mégawatts (MW). [7] DATA4 Paris-Saclay / Les campus de Data Centers les plus grands et les plus puissants d’Europe : https://www.data4group.com/ [8] Site verity systems, « La France s’impose comme le centre de données de l’Europe », 12 mai 2025 : https://veritysystems.com/fr/la-france-simpose-comme-le-centre-de-donnees-de-leurope/?utm_source=chatgpt.com [9] RTE, « Data centers : 11 chiffres sur leur essor en France et leurs besoins en électricité » : https://www.rte-france.com [10] Directive EU 2023/1791 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32023L1791&utm_source=chatgpt.com [11] Les Echos, « Data centers à Paris : passer du fléau à l’aubaine », 2017 : https://www.lesechos.fr/2017/04/data-centers-a-paris-passer-du-fleau-a-laubaine-157600 [12] Site Seine Saint-Denis « le plus grand data center de France », 5 juillet 2024 : https://seinesaintdenis.fr/actualite/emploi-entrepreneuriat/Le-plus-grand-data-center-de-France/ [13] Le Monde, « A l’ombre du data center de La Courneuve », 3 juillet 2024 : https://www.lemonde.fr/sport/article/2024/07/03/a-l-ombre-du-data-center-de-la-courneuve-ou-l-on-jardine-en-parlant-politique-mais-peu-des-jeux-olympiques_6246196_3242.html?utm_source=chatgpt.com