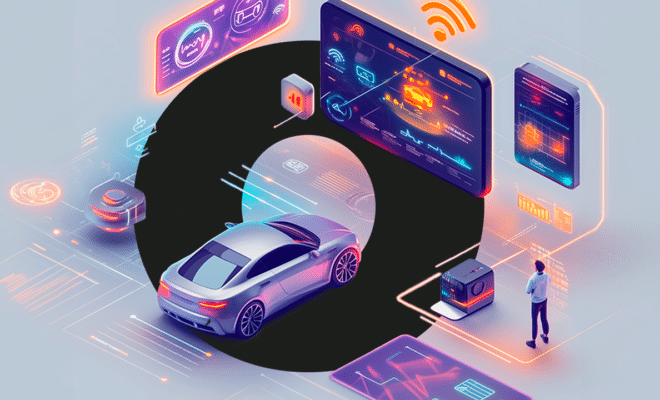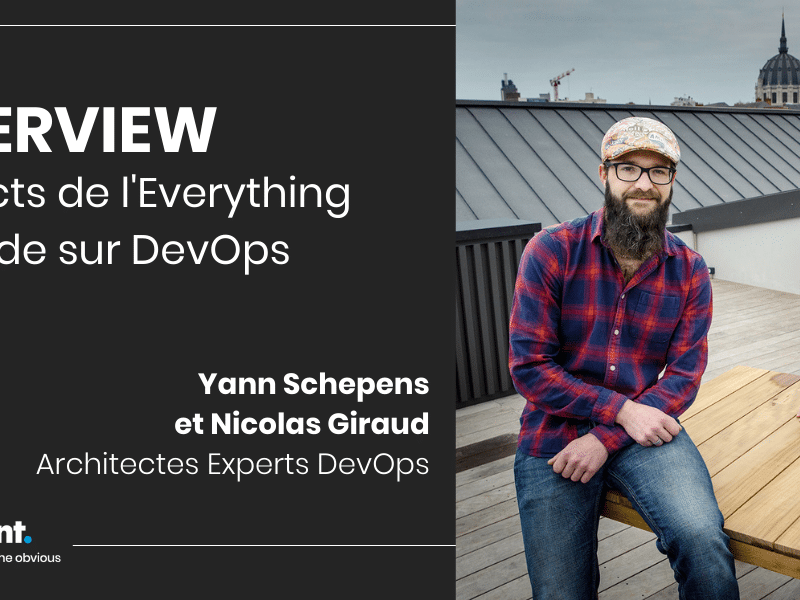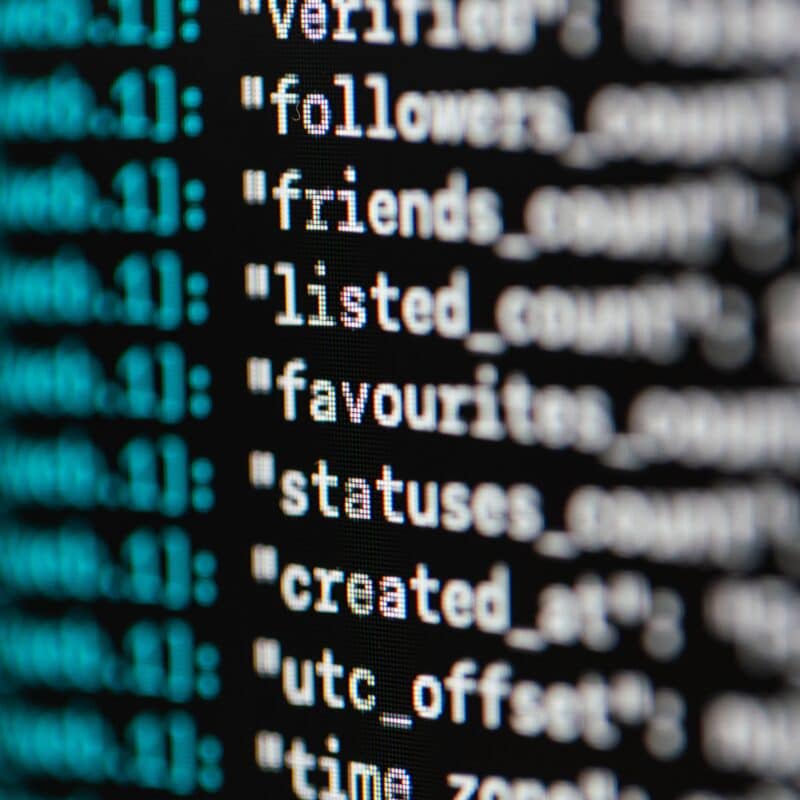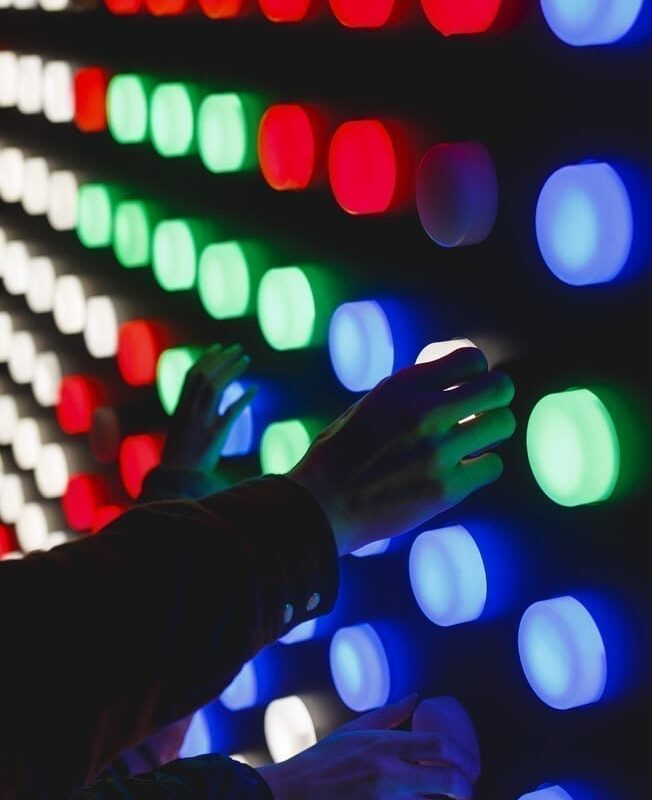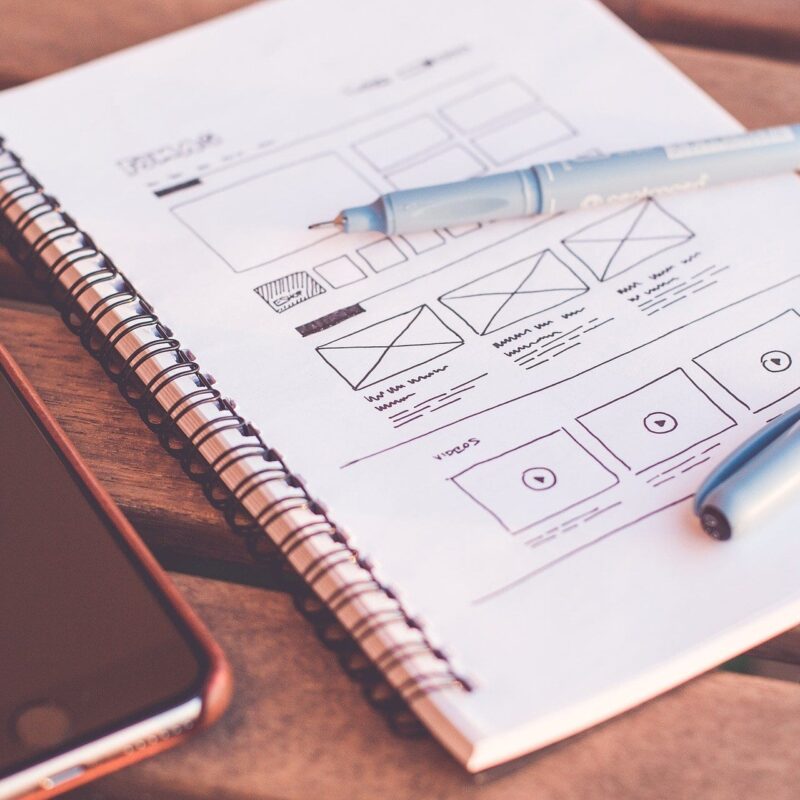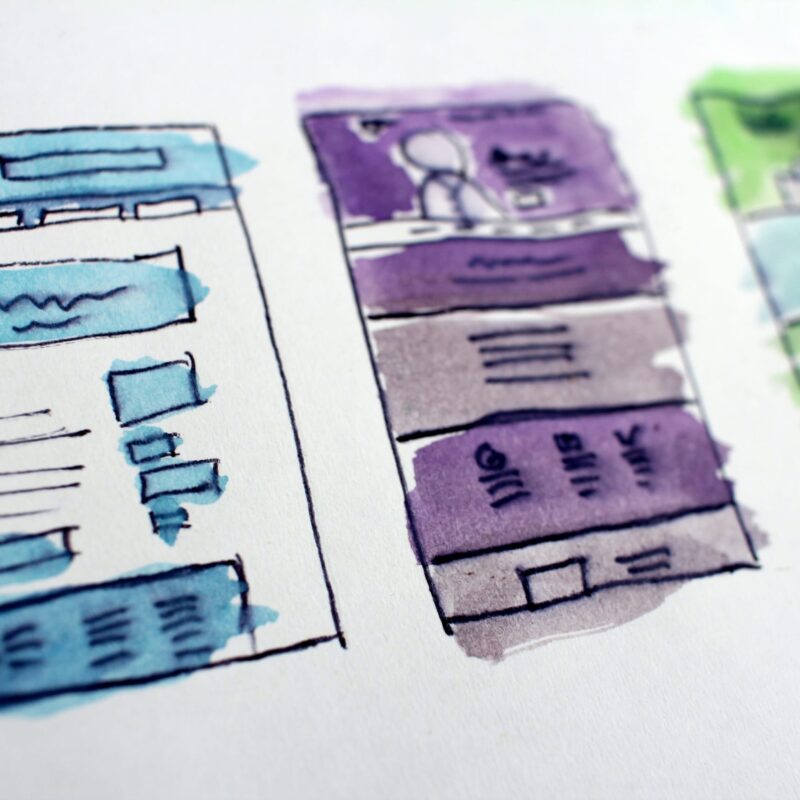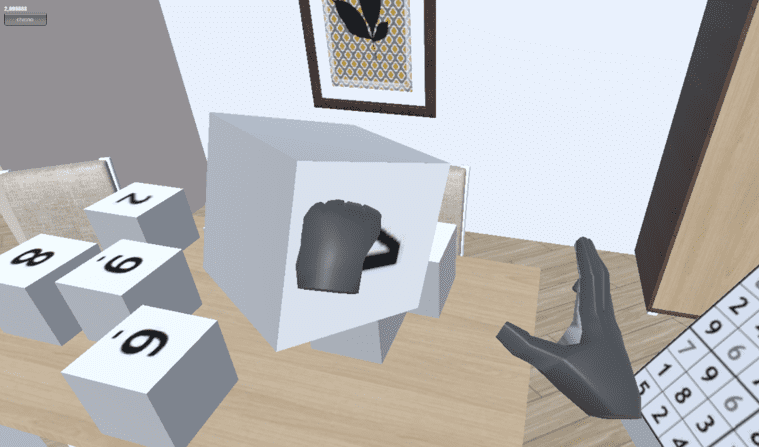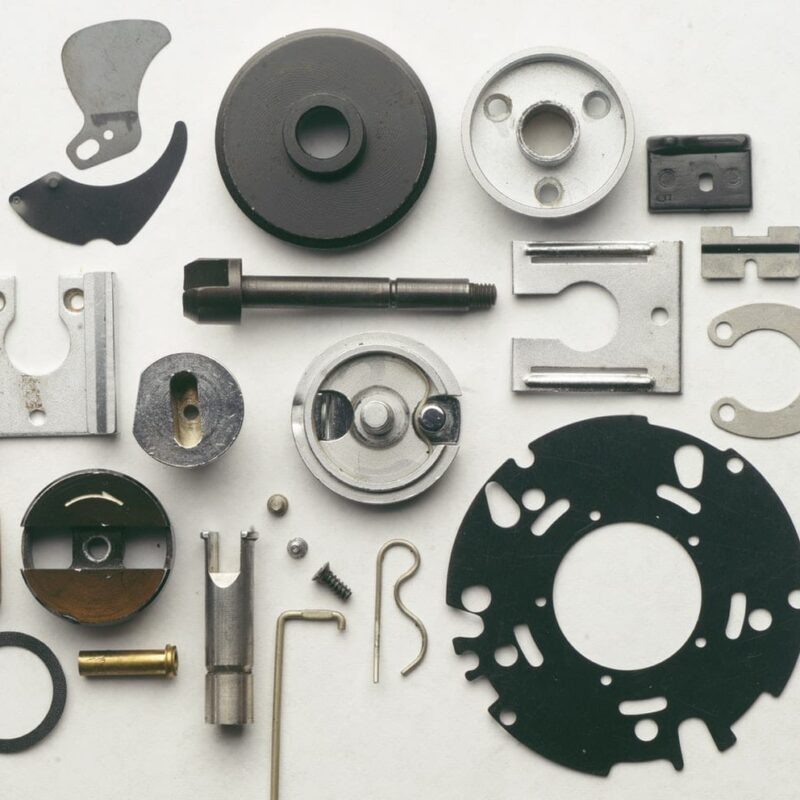Le syndrome de l’imposteur, fortement présent dans le secteur technologique, peut affecter chacun d’entre nous, étudiants comme développeurs confirmés, à tout moment. Il apparaît souvent lorsque nos compétences sont mises à l’épreuve : une présentation incompréhensible ou un projet aux enjeux complexes, et nous voilà poussés dans nos retranchements. Ce phénomène peut réellement entamer notre confiance en soi. Ce-dernier nous incite à abandonner nos ambitions sous le poids de pensées dépréciatives.
Mais ces perceptions sont-elles vraiment fondées ? Prenons l’exemple d’une présentation client lors d’un projet. La comparaison avec le travail d’un collaborateur peut déclencher une spirale de doutes injustifiés : « Je ne suis pas du tout prête », « Ma présentation est moins bien écrite ! », « Mon collègue est bien meilleur que moi ! »…
Même face au succès, le syndrome de l’imposteur peut persister. Ainsi, remporter un appel d’offre pourrait être attribué à la chance plutôt qu’au mérite. Lorsqu’on apprend davantage à trouver l’information plutôt qu’à la mémoriser, il est normal de développer un sentiment d’illégitimité : on ne possède pas réellement la connaissance.
Pas de panique ! Il est possible de surmonter cet obstacle en adoptant une approche positive de soi. C’est le premier pas vers une introspection pour construire une image plus juste de vos compétences. Finis les doutes et biais cognitifs qui vous déprécient !
En retrouvant confiance en vos capacités, de nouveaux horizons s’offrent à vous : un code plus serein, moins d’anxiété et donc une meilleure appréciation de vous-même.
Syndrome de l’imposteur : déconstruire les biais et retrouver confiance en soi
Selon le psychiatre Nicolas Neveux, les personnes souffrant du syndrome de l’imposteur ont tendance à se dévaluer de façon excessive
2. Ce syndrome a été étudié pour la première fois par les psychologues cliniques Pauline Rose Clance et Suzanne A. Imes, qui mèneront une étude en 1978 chez 150 femmes. Toutes étaient reconnues pour leur excellence dans l’exercice de leur profession. Dans leur étude « The Imposter Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention »
3, les deux psychologues ont déterminé des facteurs à l’origine de ce syndrome, comme la culture ou les stéréotypes de genre. Des comportements amplifiant ce sentiment d’imposture y sont également décrits, comme le « syndrome du travail intense » ou le port d’un masque émotionnel (ou intellectualité feinte).
Être un imposteur, c’est donc souvent baser sa vie sur une phrase : « Je suis nul
4». Évidemment, cela est faux ! Il y a donc une différence entre ce que l’on pense de soi et la réalité. Ce biais va générer des comportements visant à s’adapter à cette soi-disant incompétence : on parle de surcompensation
5.
Fournir des quantités de travail colossales, pour espérer rattraper le retard qu’on pense avoir accumulé, constitue un des exemples courants. Une réussite est assimilée à de la chance ou au travail de quelqu’un d’autre
6. Un échec vient confirmer l’imposture. Tout compliment est rejeté et perçu comme non mérité
7.
Ces mécanismes psychologiques génèrent parfois des contradictions internes. Les échecs et les réussites ne sont pas en effet perçus de la même manière. Et malheureusement, certains ont davantage tendance à se focaliser sur les échecs (biais de négativité
8).
La personne atteinte du syndrome de l’imposteur peut dès lors nourrir des attentes irréalistes envers elle-même.
On observe alors un cycle contre-productif :
- Je fournis un travail énorme dans le but de maîtriser parfaitement un sujet en pensant combler un retard :
Pour rattraper mon équipe qui, selon moi, maîtrise bien mieux Angular, je passe mes soirées et weekend à m’autoformer.
- Cet effort demande une grande quantité d’énergie et ne me permet pas d’atteindre des objectifs surréalistes.
- Je suis déçue de moi-même, je perds ma motivation : j’avais raison, je suis un imposteur.
Ce cycle génère une perte progressive de confiance en soi : la méthode de travail est inadaptée et vient confirmer les craintes d’incompétence. On s’auto-sabote et on bloque notre progression.
Heureusement, nous sommes désormais conscients de ces biais qui faussent notre jugement ! Il s’agit maintenant de les désapprendre et d’adapter son cadre de travail.
Trouver sa méthode d’apprentissage
Corriger ces biais cognitifs, plus facile à dire qu’à faire ! Oui, c’est difficile et cela va prendre du temps. Et devinez quoi ? Vous allez sans doute vous décourager à plusieurs reprises. Et c’est totalement normal.
Il est primordial d’adopter une démarche d’expérimentation active, de résilience face aux difficultés et d’ajustement continu des méthodes en fonction de ses propres besoins et préférences.
Reconnaître la difficulté du changement cognitif est l’étape la plus longue et sinueuse. C’est ici que vous traverserez éventuellement une phase de démotivation, mais vous en sortirez plus fort ! Transformer son mode de pensée n’est pas une mince affaire. Il est normal de rencontrer des difficultés à ce stade.
Trouver votre méthode d’apprentissage passe inévitablement par de nombreux essais, une phase exploratoire débute pour vous. Expérimentez diverses stratégies et prenez des notes, l’une d’elle sortira du lot. Vous retrouverez l’apprentissage par imitation, par la pratique, de manière collaborative ou encore via l’utilisation de cartes mentales, d’audios, de jeux… Vous trouverez, cela ne fait aucun doute ! Veillez à appliquer rigoureusement chaque méthode pendant une longue période avant d’émettre votre opinion sur son efficacité. Après plusieurs essais, vous saurez déterminer l’approche qui correspond le mieux à votre façon de fonctionner et d’apprendre.
Un autre élément à prendre en compte lors de vos essais, fixez-vous des objectifs réalistes, atteignables et mesurables.
Lorsqu’on est persuadé d’être en retard par rapport aux autres, on peut être tenté par des objectifs énormes, qui nous permettraient de rattraper ce retard : Je vais apprendre Java en trois semaines, car tous mes collègues maîtrisent ce langage bien mieux que moi.
Ce comportement nous conditionne pour l’échec et mène à la dévalorisation.
À l’inverse, fixer des objectifs plus petits avec des délais est beaucoup plus sain et efficace ! On retrouve ce type de raisonnement dans des méthodes comme la « Stratégie des petits pas
9 » : Dans un premier temps, demander conseil à des collègues sur l’apprentissage de Java. Par où commencer ? Apprendre d’abord les bases pendant deux semaines, puis se concentrer ensuite sur des notions plus précises.
Une fois votre méthode d’apprentissage trouvée, vous pourrez aborder plus sereinement votre progression professionnelle.
Ne plus se comparer aux autres
Nous l’avons évoqué, le syndrome de l’imposteur se manifeste par un sentiment persistant de doute de soi. Par ailleurs, ce dernier est alimenté par une tendance à se comparer constamment à nos pairs.
La comparaison est un processus naturel qui se manifeste dès l’enfance. Il permet entre autres de repérer les disparités de traitement. Il offre un point de référence pour situer nos propres expériences et compétences par rapport à celles des autres. Il fixe par-là un cadre qui influence nos actions et nos pensées. Il peut enfin stimuler notre ambition
10.
Cependant, malgré tous ses bénéfices, la comparaison doit rester modérée. Elle peut amener à placer les autres sur un piédestal et à se dévaloriser
11. D’autant plus que l’on a tendance à comparer l’incomparable ! Une collègue avec dix ans d’expérience ou un parcours différent du nôtre disposera immanquablement de compétences plus avancées.
Ce biais est renforcé lorsque la personne atteinte du syndrome de l’imposteur présente un trouble psychique ou une neuroatypie. Cette-dernière désigne un fonctionnement différent de la norme. On y retrouve, entre autres, l’autisme, la dyslexie ou encore le trouble déficitaire de l’attention (TDA).
Le cerveau d’une personne neurotypique sans trouble psychique ne fonctionne pas du tout de la même manière. Il est alors encore plus absurde de se comparer aux autres en tant que personne neuratypique.
Une personne dyslexique consacrera plus de temps à lire et comprendre un mail : cette réalité est complètement indépendante de sa volonté et ne reflète en aucun cas un manque d’investissement. Il en est de même pour les personnes avec des difficultés de concentration.
À l’heure actuelle, notre société nourri encore peu de considération pour les handicaps psychiques. « 88% des proches estiment qu’au sein de la société actuelle la personne en situation de handicap et ses proches sont stigmatisés
12 ». En outre, « près de deux tiers des Français pensent que la société ne favorise pas l’intégration des personnes en situation de handicap mental et psychique
13 ».
En 2024, cette forme de handicap s’est vue représentée pour la première fois dans les quelques disciplines des Jeux Paralympiques de Paris (Para-athlétisme, Para-natation, Para-tennis de table). L’entourage alimente ce biais et conforte dans l’idée que nous ne sommes pas à la hauteur : on confond alors le handicap avec une incompétence.
Il est donc primordial de désapprendre cet énième biais. Une compétence n’est pas figée, nous apprenons sans cesse et nous progressons à notre rythme. Il ne faut pas non plus croire tout ce que l’on voit, à l’instar des réseaux sociaux, qui sont loin de refléter la réalité. Identifier les situations qui déclenchent une comparaison peut aider à lutter contre ce biais. Enfin, le succès des autres n’impacte pas notre réussite. S’il est reconnu dans sa profession, cela ne signifie pas que nous sommes en échec.
Pensez-vous être victime du syndrome de l’imposteur ?
Nous avons examiné différents processus de pensée à l’origine du syndrome de l’imposteur. Principalement dû à une comparaison constante et excessive, ce comportement génère des biais qui faussent notre jugement et nous poussent vers la dévalorisation.
Vous serez amenés à modérer ces comparaisons et à compenser ces biais pour sortir de ce sentiment d’imposture. Nous avons d’ailleurs souligné l’importance de s’éduquer sur des domaines comme la santé mentale et les handicaps psychiques.
Que vous vous soyez retrouvé dans cet article, ou que vous ayez reconnu quelqu’un de votre entourage, il est toujours temps de passer à l’action !
1 «
58 Percent of Tech Workers Feel Like Impostors », teamblind.com, 5 septembre 2018
2 Dr Nicolas Neveu, «
Syndrome de l’imposteur : comment le reconnaître et le traiter ? », e-psychiatrie.fr.
3 Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, «
The Imposter Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention », paulineroseclance.com, page 1 8 pages, 1978.
4 Dr Nicolas Neveu, «
Syndrome de l’imposteur : comment le reconnaître et le traiter ? », e-psychiatrie.fr.
5 Ibid.
6 Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, «
The Imposter Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention », paulineroseclance.com, page 1 8 pages, 1978.
7 Ibid.
8 « Biais de négativité — également connu sous le nom d’effet de négativité, est la notion que, même à intensité égale, les choses de nature plus négative ont un effet plus important sur l’état et les processus psychologiques que les choses neutres ou positives. », «
Biais cognitif », wikipedia.org.
9 Magalie Le Gall, «
Tout un tas de petits pas sur le chemin de l’apprentissage », cnrs.fr, page 2, 7 pages, 8 Février 2017.
10 Sébastien Bohler, Matthieu Cassotti et Michael Stora, «
Est-il toujours bon de se comparer aux autres ? », radiofrance.fr, 2 mai 2023.
11 Ibid.
12 Cindy Lebat, «
Enquête sur les préjugés et stéréotypes à l’égard du handicap en France », cncdh.fr, page 61, 102 pages, avril 2021.
13 Etienne Mercier, «
Inclusion et insertion des personnes en situation de handicap psychique et mental », ipsos.com, 21 mars 2017.